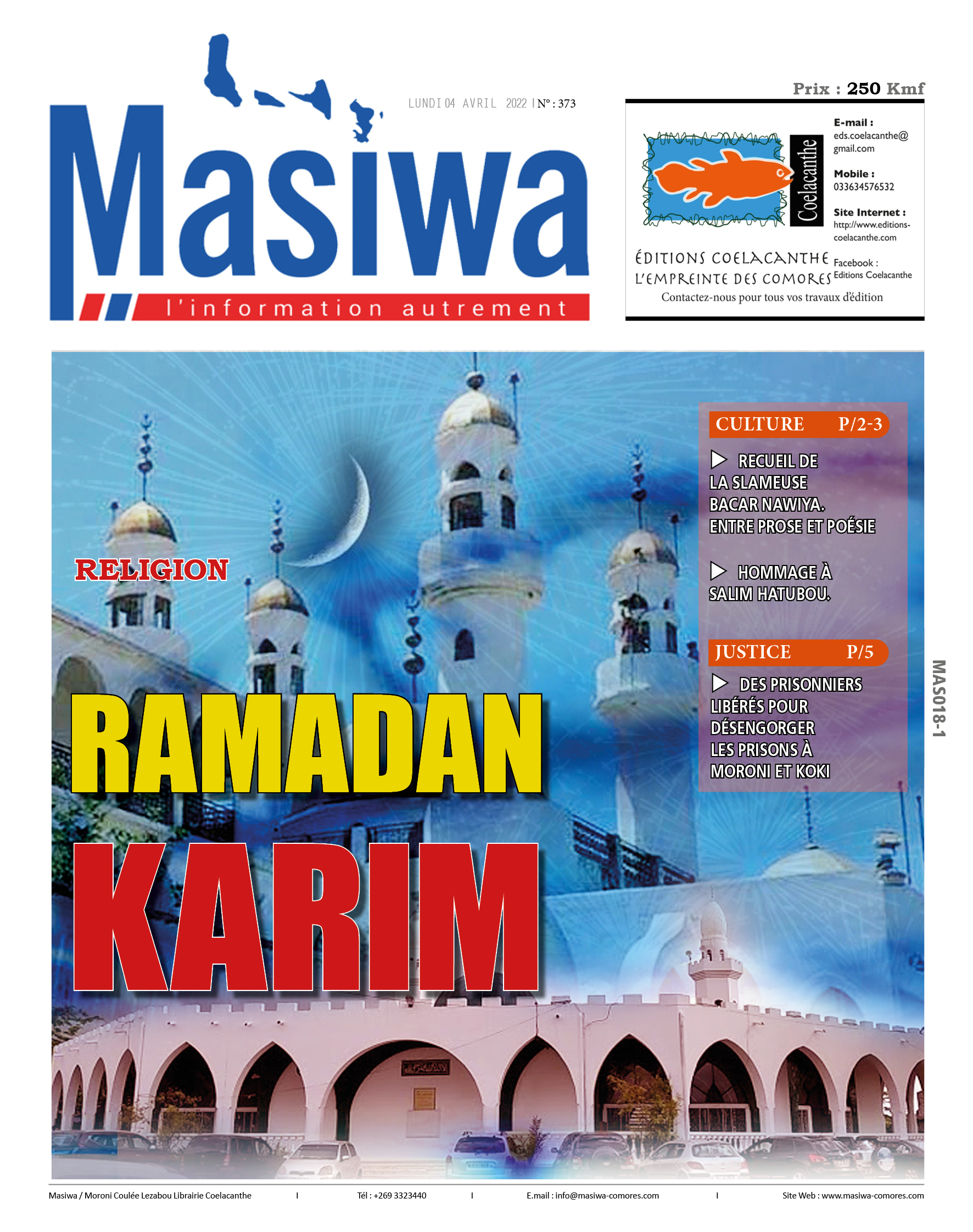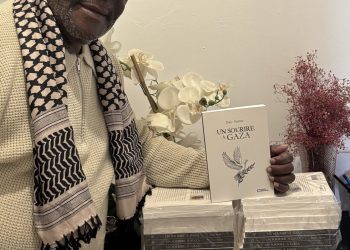Les Comoriens doivent-ils continuer à importer leur nourriture et ainsi la pauvreté ou se décider enfin à créer les conditions d’une autosuffisance alimentaire, comme Ali Soilihi l’avait imaginé et commencé à mettre en œuvre ?
Par Younoussa Hassani
L’assassinat d’Ali Soilihi en 1978 a marqué un tournant tragique dans l’histoire des Comores. Visionnaire, il avait compris que l’avenir du pays reposait sur l’autosuffisance alimentaire et l’émancipation des masses rurales. Son approche pragmatique, centrée sur l’agriculture et l’organisation des paysans en coopératives, témoignait d’une profonde compréhension des réalités comoriennes. Aujourd’hui, près de 47 ans après sa disparition, son héritage reste vivant dans l’esprit de nombreux Comoriens, mais force est de constater que les Comores peinent encore à réaliser le potentiel agricole immense de leur territoire.

Le constat est amer : malgré une terre fertile et des ressources naturelles abondantes, les Comores continuent d’importer une grande partie de leurs produits alimentaires. Cette dépendance vis-à-vis de l’extérieur est un paradoxe pour un pays qui pourrait nourrir sa population et même exporter ses surplus. Comme le disait Mossadeck Bally, « Lorsqu’on exporte des produits, on exporte la richesse, et lorsqu’on importe, on importe la pauvreté ». Cette phrase résonne comme un rappel cruel de l’échec des politiques agricoles actuelles.
La question qui se pose est de savoir où réside la responsabilité de cette situation. Est-ce celle d’un gouvernement qui ne parvient pas à mettre en place des politiques publiques efficaces pour soutenir l’agriculture ? Ou est-ce celle des jeunes, souvent attirés par des emplois administratifs plutôt que par le travail de la terre ? La vérité est sans doute un mélange des deux. D’un côté, les dirigeants ont la responsabilité de créer un environnement propice au développement agricole, en investissant dans les infrastructures, en soutenant les agriculteurs et en encourageant l’innovation. De l’autre, les jeunes doivent également prendre conscience de l’importance de l’agriculture pour l’avenir du pays et s’engager dans ce secteur avec fierté et détermination.
Une solution pourrait être que l’État achète des terres et les mette à disposition des jeunes diplômés en agronomie, qui manquent souvent de moyens pour exploiter leurs compétences. En créant un fonds dédié, le gouvernement pourrait financer des projets agricoles innovants, sélectionnés sur la base de concours ou de mérite. Cela permettrait non seulement de lutter contre le chômage, mais aussi de dynamiser le secteur agricole en y intégrant des connaissances modernes et des techniques avancées.
Par ailleurs, l’idée de mobiliser les forces de l’ordre pour participer à des travaux agricoles, bien que provocante, mérite réflexion. Si l’objectif premier de la police et de la gendarmerie est de servir et protéger la population, pourquoi ne pas envisager des missions temporaires ou complémentaires visant à soutenir l’autosuffisance alimentaire ? Cela pourrait renforcer le lien entre les institutions et les citoyens, tout en contribuant à la sécurité alimentaire du pays.
Enfin, la création d’une société d’État chargée d’acheter les produits agricoles à un prix juste et de les redistribuer ou de les transformer pourrait structurer le marché et garantir des débouchés stables aux agriculteurs. Cela permettrait également de réguler les prix pour les consommateurs, rendant les produits locaux accessibles à tous.
En somme, les Comores ont tous les atouts pour devenir un modèle d’autosuffisance alimentaire en Afrique. Mais pour y parvenir, il faut une volonté politique forte, une implication active de la jeunesse et une réelle prise de conscience collective. Ali Soilihi avait tracé la voie ; il appartient désormais aux générations actuelles et futures de poursuivre son rêve et de transformer ce potentiel en réalité. Le temps est venu de planter les graines d’un avenir meilleur, pour que les Comores ne soient plus un pays qui importe la pauvreté, mais un pays qui exporte la richesse de sa terre et de son peuple.