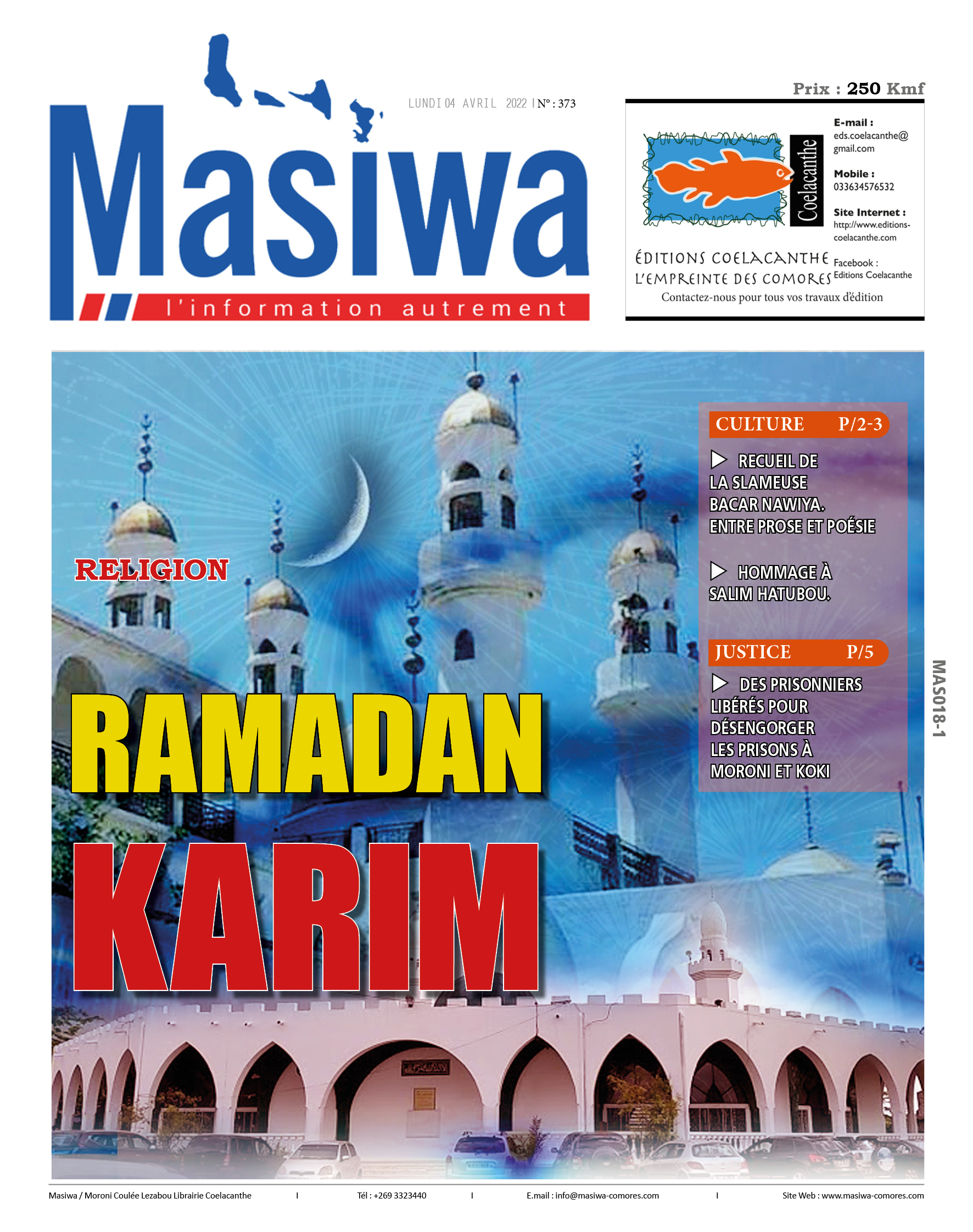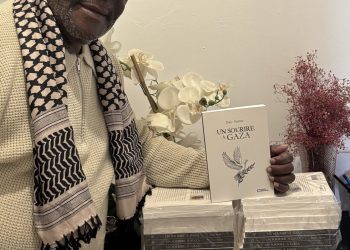À l’heure où la guerre fait rage dans l’est du Congo, j’aimerais revenir au temps de Tippo Tip’s, au moment de l’arrivée des Arabo-Swahilis dans cette région.
Par Fahmy Nassor
Ceux qu’on appelait les Arabo-Swahilis étaient, en réalité, une composition ethnique plus complexe. Il y avait des Arabes d’Oman et du Yémen, mais aussi des Baloutches, des Indiens et des Comoriens.

L’histoire de l’Afrique centrale et orientale est marquée par de nombreuses migrations, des échanges commerciaux et des influences culturelles riches. Parmi les communautés qui ont joué un rôle clé dans la région, les Comoriens occupent une place souvent négligée. Leur présence au Congo, notamment dans l’est du pays, est intimement liée au commerce swahili, à l’administration locale et à l’expansion de l’Islam.
Dès la seconde moitié du XIXe siècle, des Comoriens ont rejoint les réseaux commerciaux dominés par les marchands arabes et swahilis, participant activement à l’essor économique de la région. Ce groupe, bien que minoritaire, a exercé une influence considérable dans le commerce de l’ivoire, l’administration locale et la diffusion de la langue et de la culture swahilies.
Les origines de la présence comorienne au Congo
Les Comoriens ont longtemps été des navigateurs et commerçants actifs sur les routes de l’océan Indien et des côtes africaines. Leur présence en Afrique de l’Est est bien documentée, notamment à Zanzibar, au Mozambique, en Tanzanie et au Burundi.
C’est dans ce contexte que des Comoriens se sont établis au Congo, principalement dans l’est du pays, dès les années 1860. Ils faisaient partie des caravanes commerciales organisées par les marchands swahilis et omanais, qui exploitaient les ressources locales, notamment l’ivoire et les épices.
Le voyageur français E. Trivier, qui visita le Congo en 1888, mentionne un chef comorien appelé Kibonge (c’est un surnom), installé à Kirundu, sur le fleuve Congo. Ce dernier incarne la figure du Comorien influent, menant à la fois des activités commerciales et jouant un rôle politique dans la région.
Les Comoriens dans le commerce et l’administration
Les Comoriens sont dans le commerce de l’ivoire et des épices. Le commerce transcontinental était dominé par des marchands swahilis et arabes, mais les Comoriens y jouaient un rôle de premier plan en tant qu’intermédiaires. À l’époque, Tippu Tip, un célèbre marchand et gouverneur swahili, mentionne la présence de Comoriens parmi ses associés. Ces derniers contribuaient au commerce de l’ivoire en reliant les marchés de l’intérieur du continent aux comptoirs côtiers de Zanzibar.
Les Comoriens sont également dans l’administration locale. Certains Comoriens ont également accédé à des postes administratifs dans les colonies commerciales établies à l’intérieur des terres. Le cas de Mohamed Bin Ahmed, alias Kibonge, est emblématique. Ce chef comorien, après avoir participé à l’exploration de territoires entre le Lomami et Kisangani, est devenu gouverneur de Kirundu. Il a d’abord coopéré avec les Européens, notamment avec l’explorateur Henry Morton Stanley en 1876, avant de se rebeller contre l’avancée coloniale belge et d’être exécuté en 1894.
Les Comoriens, soldats et interprètes
Les Comoriens ont également servi comme soldats, appelés Askaris, dans diverses expéditions européennes et africaines, au service des explorateurs. En 1860, des soldats comoriens furent enrôlés par David Livingstone lors de son expédition sur le Zambèze. John Kirk, qui l’accompagnait, souligna la bravoure et la loyauté des soldats venus de l’île de Johanna (Anjouan).
Dans le cadre des interactions entre Européens et marchands swahilis, les Comoriens jouèrent aussi un rôle essentiel en tant qu’interprètes et scribes. Ali Hamadi Shanzi Mchangama, né aux Comores, devint l’interprète du gouverneur Kibonge. Il parlait couramment le français et servait d’intermédiaire entre les autorités coloniales belges et les marchands swahilis.
La langue swahilie, largement utilisée dans la région, a permis aux Comoriens de s’intégrer facilement aux réseaux de communication et d’administration.
L’influence religieuse dans le contexte de l’expansion de l’Islam
Les Comoriens ne se limitaient pas aux activités commerciales et militaires. Ils ont également joué un rôle majeur dans la propagation de l’Islam à l’intérieur du continent africain.
Les Comoriens étaient souvent affiliés aux grandes confréries soufies, notamment la Qadiriyya et la Chadhiliyya.
Ainsi, Mohamed Bin Ahmed Bin Abu Bakr, dit « l’Anjouanais » (1850-1904), a été une figure religieuse influente dans la propagation de l’islam de la côte orientale jusqu’à l’intérieur du Congo.
Saïd Mohamed Al Maarouf, un autre religieux comorien, a contribué à l’expansion de l’islam à Tabora et Ujiji en Tanzanie.
Au Burundi, Sharif Bin Ahmed Bin Abdl Rahman, un érudit Qadiriyya basé à Rumonge, fut une figure clé des années 1950.
Cette influence religieuse s’est traduite par l’islamisation progressive de certaines populations locales, qui ont adopté à la fois la langue swahilie et les pratiques islamiques.
La perception des Comoriens par les Européens
La présence de Comoriens était souvent mal vue par les Européens. L’influence des marchands et administrateurs comoriens était perçue comme une menace par les colonisateurs européens. Le contrôle exercé par les Arabo-Swahilis sur le commerce de l’ivoire et leur influence religieuse entraient en conflit avec les ambitions européennes après la Conférence de Berlin (1884-1885).
Mais, les Européens ont su diviser pour mieux régner. Ils les ont parfois opposés aux populations locales, les qualifiant de wawungwana (gens civilisés) par opposition aux washenzi (sauvages). Cette dichotomie contribua à justifier les campagnes militaires contre les chefs comoriens et swahilis, à l’image de la répression subie par Kibonge.
Un héritage culturel et linguistique durable
Bien que l’influence des Comoriens ait diminué après l’établissement de la colonisation européenne, leur héritage d’une part à travers la langue swahilie, qui reste une des principales langues véhiculaires dans l’est du Congo. D’autre part, à travers les traditions islamiques, qui continuent d’influencer certaines communautés locales.
L’influence des Comoriens demeure également à travers l’histoire de certaines routes commerciales, où les Comoriens ont joué un rôle de premier plan.
L’histoire de la présence comorienne au Congo est un témoignage fascinant des liens entre l’océan Indien et l’intérieur du continent africain. Des commerçants et des administrateurs, des soldats et des érudits religieux, les Comoriens ont contribué de manière significative à l’histoire sociale, économique et culturelle de la région.
Malgré leur relative invisibilité dans l’historiographie dominante, leur impact se retrouve encore aujourd’hui à travers la langue swahilie, l’Islam et les récits des échanges commerciaux du XIXe siècle.
Explorer cette histoire, c’est mieux comprendre les interactions entre l’Afrique de l’Est et l’Afrique centrale, et rendre hommage à ces acteurs méconnus qui ont façonné le Congo d’hier et d’aujourd’hui.