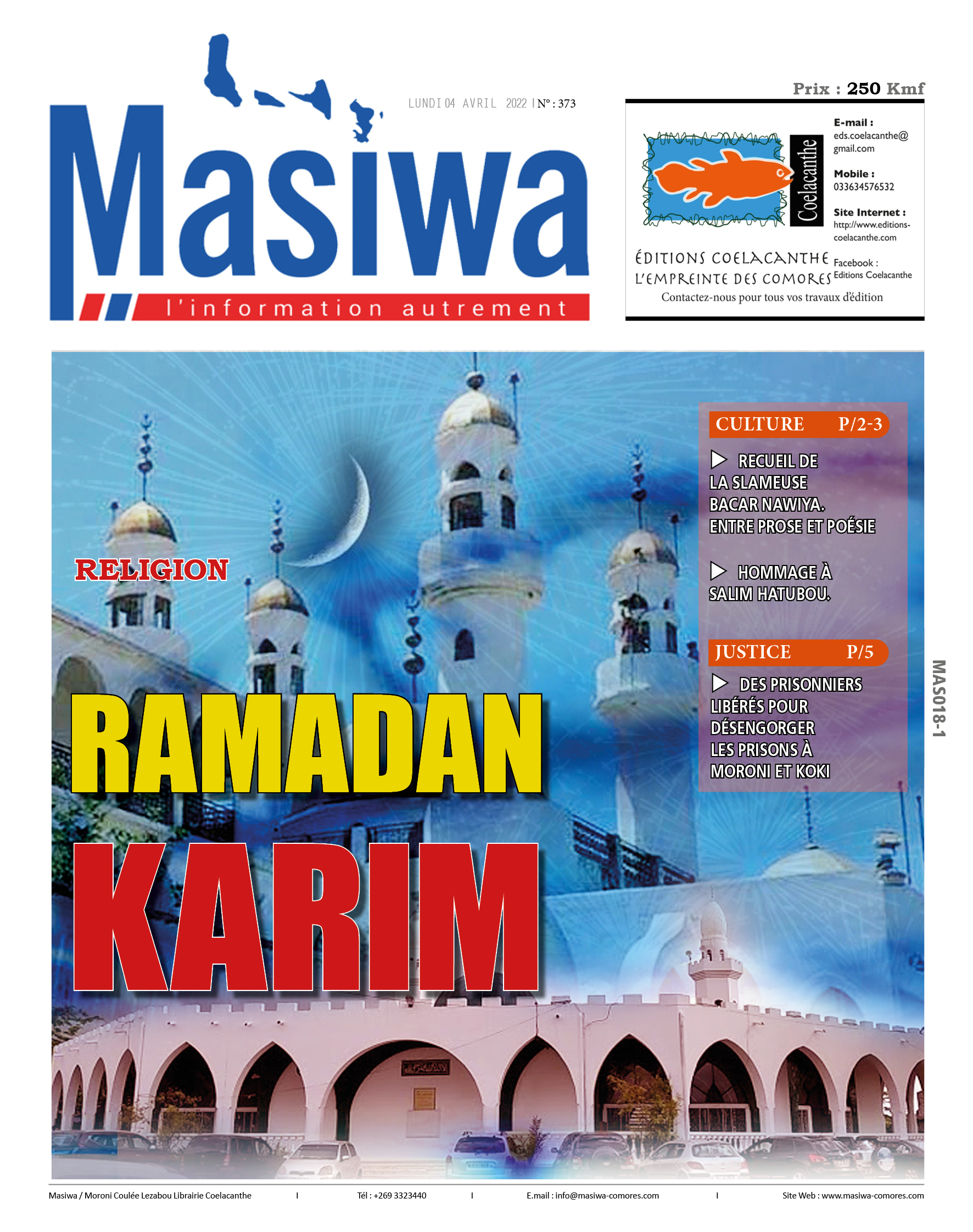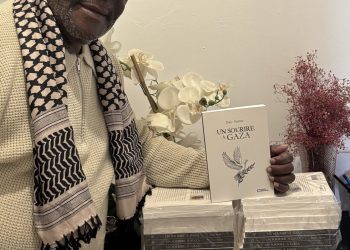Les Comoriens commémoraient hier le 55e anniversaire du décès de Saïd Mohamed Cheikh, député à l’Assemblée nationale française, puis président du Conseil de gouvernement des Comores de 1961 à 1970.
Par MOHAMED Bakari. Paris, le 15 mars 2025
Said Mohamed Cheikh, nous l’avions souligné dans un papier publié l’année dernière, se trouvait à la croisée de deux cultures qui avaient grandement influencé sa conception du monde : la religion musulmane, source spirituelle de son éducation de base et la culture française assimilationniste acquise à l’école coloniale. Ce sont deux cultures et deux éducations diamétralement opposées et en conflit permanent dans la société comorienne post-première guerre mondiale.

Un bon musulman
Il voulait, avec beaucoup de difficultés, les réconcilier pour garantir la sortie des Comores du sous-développement économique et socioculturel dans lequel l’Archipel végétait depuis le début de la colonisation. Ce fut une vaste ambition qui nécessitait, on s’en doute, du doigté, de la finesse d’esprit et de la patience. Des qualités qu’il possédait si l’on en croit son entourage familial et ses proches collaborateurs.
Et pourtant, de ces deux cultures, la religieuse s’était imposée. Elle avait pris l’ascendant dans le corpus des valeurs idéologiques sur lesquelles le président du Conseil s’était appuyé pour gouverner le pays en étroite collaboration avec le pouvoir colonial.
Dès son irruption au premier rang de la classe politique comorienne, le président Saïd Mohamed Cheikh avait compris l’impérieuse nécessité de concilier la religion musulmane avec les traditions et les coutumes dominantes dans l’Archipel.
En bon croyant et musulman pratiquant formé dans les écoles coraniques, il a puisé dans le livre sacré du Coran les préceptes et les principales valeurs qui fonderont les bases de sa conception du pouvoir. Des valeurs simples et élémentaires recommandées aux musulmans. Il en fera son corpus idéologique et spirituel.
Saïd Mohamed Cheikh cultivait et entretenait la conception répandue dans la mentalité locale selon laquelle « les gouvernants détiennent le pouvoir et puisent leur légitimité de la volonté et de la puissance divine ».
Dans « son Archipel » comme il aimait si bien le dire régnaient l’ignorance et l’obscurantisme. Le député devenu plus tard président du Conseil prêchait la soumission de la population vis-à-vis de l’autorité qu’il incarnait.
Certains historiens parlent même de paternalisme pour évoquer sa gouvernance durant son long règne.
Il avait l’habileté et l’art de recourir à la hiérarchie religieuse pour véhiculer ses messages politiques par l’intermédiaire du grand cadi, l’érudit religieux et principal juriste, les chefs des mourides ou twarika dont ses familles sont issues, les Hadjs et les maîtres des écoles coraniques qui parsemaient l’ensemble du territoire.
C’est par cette institution spirituelle et morale que le président Saïd Mohamed Cheikh contrôlait sans obstacle les mouvements de contestations et de mauvaise humeur à son encontre. Excepté l’irrédentisme maorais inspiré par Marcel Henri, Younoussa Bamana et Zaina Mdere.
Sa proximité idéologique avec l’autorité religieuse fonde l’enracinement de la soumission des populations comoriennes au pouvoir politique qui se perpétue encore aujourd’hui.
La peur de contester l’autorité conférée à l’élite religieuse demeure ancrée dans les mentalités des contemporains du président Saïd Mohamed Cheikh.
Qui aurait osé critiquer les ordres et les sermons du Mufti Al Habib Omar Ben Aboubakr Ben Soumette, de Maulana Kaadhu, Said Mohamed Abdouroihmane et de Fundi Djelani pour ne citer que ces grands noms ?
Tous les successeurs du président du conseil à l’exception d’Ali Soilhi Mtsachiwa pendant la parenthèse révolutionnaire se sont servis du pouvoir de ces autorités religieuses pour gouverner le pays.
Il va sans dire que la principale alliée naturelle des régimes qui se sont succédé dans l’Archipel pendant ces soixante-quinze dernières années demeure le pouvoir religieux et celui des enturbannés.
Les hommes politiques ont besoin des sermons moralisateurs du cadi, des cheikhs, des hatubs, des mafundi et du grand mufti depuis la naissance de la République pour contraindre les populations au silence.
Le colonisateur l’avait compris en premier. Les Résidents et les Administrateurs coloniaux connaissaient l’importance et le rôle très influents des chefs spirituels et religieux envers leurs coreligionnaires.
Le pouvoir de la coutume
Saïd Mohamed Cheikh l’avait sans doute aussi appris auprès de ses supérieurs hiérarchiques coloniaux lorsqu’ils lui ont confié avec Cheikh Ahmed Kamardine la mission de dresser un rapport sur le pèlerinage aux Comores.
Le second pilier sur lequel Saïd Mohamed Cheikh s’était appuyé politiquement pour se maintenir longuement au pouvoir et gérer à sa guise les affaires comoriennes était le pouvoir coutumier représenté par la grande notabilité.
C’est une source et un vivier inépuisable. Un corps social dans lequel sont recrutés les hommes chargés de faire respecter l’ordre et l’autorité incontestables du premier magistrat du pays.
Dans les quatre coins des villages de l’Archipel, le député au Palais Bourbon devenu président du conseil en 1961 s’arrachait les grands noms inscrits sur les frontispices des « bangwe »
Il s’agissait des notables qui avaient accompli les devoirs sociaux et les obligations traditionnelles et coutumières du « Ndola Nkuwu » à Ngazidja et dans le reste des îles.
Des notables aux turbans de couleur verte, un clin d’œil à son mouvement politique qui décidaient de tout dans les villages.
Le pouvoir illimité que s’est arrogé cette caste dans l’administration et le fonctionnement de la vie quotidienne de leurs villages dépasse de loin l’autorité politique, administrative et judiciaire incarnée par l’État.
Le « Anda Na Mila » est un « État dans l’État » dans les villages jusqu’à ce jour. Un pouvoir qui ne puise sa légitimité d’aucune assise populaire ni démocratique. Les notables ne sont pas des élus ni des personnes désignées par leurs concitoyens villageois pour les représenter ou servir d’intermédiaires avec le pouvoir politique. Ils s’autodésignent et s’arrogent cette autorité en raison du rang très élevé qu’ils occupent dans la hiérarchie sociale.
Selon les us et coutumes féodaux fortement en vigueur à cette époque, seuls les hommes qui s’étaient acquittés de toutes les étapes du grand mariage, les sommités de la hiérarchie bénéficiaient de tous les droits qui régissent la vie quotidienne dans leurs villages.
Dans cette société féodalisée, les règles les plus élémentaires de la démocratie étaient considérées comme des atteintes graves aux institutions hiérarchiques, aux mœurs et aux coutumes locales.
La liberté de s’exprimer et de fréquenter certains lieux de sociabilités (Bangwe, mosquée) était formellement contrôlée pour l’immense majorité des hommes de tous âges qui n’avaient pas accompli leur grand mariage.
Des libertés et des territoires réservés à l’infime minorité des notables.
Les femmes étaient et restent encore les plus discriminées, les exclues de ce système, réduites au rang d’« intouchables ».
Cette expropriation des droits les plus élémentaires explique la soumission et l’assujettissement de l’immense majorité des sans-voix, des exclus du système aux volontés et aux manipulations de leurs supérieurs hiérarchiques inféodés au pouvoir colonial.
Vu le pouvoir immodéré de cette notabilité dans la société comorienne soumise au joug de la France coloniale et des gouvernements de l’autonomie interne, Saïd Mohamed Cheikh et ses successeurs avaient délibérément abandonné la plénitude de la gouvernance et le contrôle des villes et des villages aux « wandru wadzima wa midji ».
C’est ce qui explique l’inexistence de l’échelon communal dans le système administratif et institutionnel comorien depuis les temps immémoriaux de la colonisation jusqu’à la promulgation de la loi du 7 avril 2011 relative à la décentralisation au sein de l’Union des Comores.
La première tentative d’instauration d’une commune à Moroni et dans d’autres localités de l’Archipel pendant les dernières heures de l’autonomie interne n’a pas fait long feu.
La France coloniale a piétiné les valeurs de la Révolution française qui a instauré par le décret du 12 novembre 1789 les communes en France et a mis fin aux seigneuries et paroisses de l’ancien régime.
Cinquante après l’indépendance, nos villages et grandes villes sont entre les mains des seigneuries des temps modernes.
Hier sous Saïd Mohamed Cheikh comme aujourd’hui, il semble quasi impossible de faire coexister deux systèmes inconciliables et incompatibles : l’institution communale prévue par la loi de la République en Union des Comores et le pouvoir archaïque et omnipotent de la notabilité dans les villes et les villages.
N’est-il pas aisé et nous le constatons encore de nos jours pour la classe politique comorienne de s’adosser sur la puissance de ce corps social pour contrôler politiquement un village ou une région tout entière ?